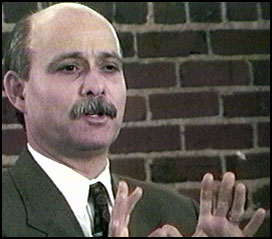|
|
Alarmiste ou prophète?
Le militantisme est un véritable
mode de vie chez Jeremy Rifkin. Né en 1943 dans le Colorado, cet
expert en économie et en relations internationales est une personnalité
influente aux Etats-Unis. Souvent appelé à témoigner
devant le Congrès américain, sur des sujets allant des menaces
de guerre bactériologique à I’étiquetage des aliments
transgéniques, conférencier sollicité dans le monde
entier, conseiller privé de nombreux chefs d’Etat, J. Rifkin doit
sa notoriété à 14 ouvrages, traitant de l’impact des
changements techniques et scientifiques sur l’économie, l’emploi,
la société et l’environnement. L’un de ses succès
majeurs, La Fin du
travail (La Découverte, 1996), fait référence
dans le débat actuel sur la responsabilité de la technologie
dans les compressions de personnel.
Dans son dernier livre intitulé
Le Siècle biotech
(La Dé-couverte, 1998), J. Rifkin met l’accent sur l’impact négatif
des nouvelles technologies génétiques, en regrettant l’absence
de débat public sur le sujet. II livre une vision effrayante du
«monde bio-industriel», tout en invitant le lecteur à
la réflexion. Cet ouvrage de vulgarisation sur le commerce génétique
a été accusé de lancer une attaque infondée
contre la science.
Juif libéral, «mais
je ne suis pas religieux», précise-t-il, J. Rifkin évoque
l’«expérience mémorable» de sa visite du camp
de concentration nazi de Dachau: «Personne ne veut qu’une telle chose
se reproduise. Mais nous devons aussi réaliser que cela peut se
rééditer, et se dessine déjà, sous des formes
que nous ne soupçonnons pas. C’est la raison pour laquelle j’ai
tellement insisté sur le nouvel aspect, commercial, de I’eugénisme.
L’ennemi, aujourd’hui, est en chacun de nous, lorsque, pour des raisons
louables, nous voulons avoir des enfants en bonne santé».
|
|
|
|
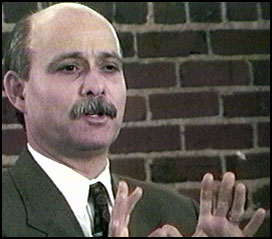
JEREMY RIFKIN
CONTRE LE MEILLEUR DES
MONDES
Le XXe siècle sera-t-il celui de
la guerre pour le contrôle des gènes? L’Américain Jeremy
Rifkin le craint, et explique pourquoi.
-
Quelle signification donnez-vous au «siècle
biotech»?
Jeremy Rifkin: Nos futurologues ont défini
de manière trop restrictive le XXe siècle comme l’ère
de l’information. En vérité, l'économie mondiale est
en train de vivre une transformation bien plus profonde. De la mise en
commun de l’informatique et de la génétique est en train
d’émerger une puissance techno-économique qui sera le fondement
du siècle biotech. Les ordinateurs sont de plus en plus mis à
contribution pour décoder et organiser l'énorme masse d’informations
génétiques qui constituent la matière première
de la nouvelle économie globale. Les firmes multinationales se sont
déjà engagées dans la création de gigantesques
complexes de recherche sur les sciences de la vie, qui dessineront le monde
bio-industriel de demain.
Les avantages à court terme de cette révolution sont considérables:
de nouvelles plantes, de nouveaux animaux, de nouveaux produits pharmaceutiques,
de nouvelles sources d’énergie vont voir le jour. Mais il faut être
naïf pour croire qu’il n’y aura pas, en contrepartie, un prix à
payer. Les conséquences environnementales, sociales et éthiques
de ces changements risquent d’être terrifiantes. La création
de clones et d’espèces transgéniques ne conduit-elle pas
à la fin de la nature? Les organismes génétiquement
modifiés ne vont-ils pas causer des dommages irréversibles
à la biosphère? N’est-il pas dangereux d’envisager de fabriquer
un bébé «parfait»?
-
En quoi tout cela diffère-t-il du combat
mené depuis toujours par l’homme pour transformer la nature?
J. R.: Il est vrai que nous n’avons cessé
de modifier la nature depuis la révolution néolithique. Mais
les nouveaux moyens de recombinaison génétique sont radicalement
différents. Avec les techniques classiques de reproduction, seul
le croisement d’espèces biologiquement voisines est possible. Aujourd’hui,
nous avons fait tomber cette barrière. Ainsi, des scientifiques
ont isolé le gène de luminescence chez la luciole et l’ont
introduit dans le code génétique d’un plant de tabac qui,
parvenu à maturité, brille 24 heures sur 24. Du jamais vu
dans la nature.
-
Dans le débat sur la thérapie génique
visant à soigner ou prévenir des maladies chez l’être
humain, vous avez soulevé la question de savoir qui doit décider
si un gène est «bon» ou «mauvais». Sommes-nous
en train d’entrer dans une ère eugénique?
J. R.: Certainement, mais pas dans le sens
ou l’entendaient les nazis. Le nouvel ordre eugénique ne sera pas
social. Il sera économique, gouverné par les lois du marché.
De futurs parents pourront bientôt programmer l’avenir biologique
de leurs enfants, avant même leur conception. La pression sociale
les incitera à vouloir gommer chez eux certains «caractères
indésirables».Vous sachant porteur d’un gène de leucémie,
ne désireriez-vous pas l’éliminer du sperme ou de l’ceuf
d’ou naitra votre enfant? Même chose pour l’obésité,
la myopie... Une fois lancé sur cette voie, il n’y a plus moyen
de s’arrêter. L’eugénisme prendra un tour véritablement
effrayant quand on intégrera les enfants dans le champ de nos expériences.
Or, déjà dans les années 80, les sociétés
Genetech et Eli Lilly ont breveté une nouvelle hormone de croissance,
issue de la recherche génétique, destinée aux quelques
milliers d’enfants atteints de nanisme aux Etats-Unis. En 1991, cette hormone
était devenue 1’un des produits pharmaceutiques les plus vendus
dans le pays. Des médecins la prescrivaient à des enfants
qui étaient simplement plus petits que la moyenne. Les distributeurs
de cette hormone font maintenant pression auprès du corps médical
pour que le fait d’être de petite taille soit assimilé à
une maladie.
-
Certains vous ont accusé d’être alarmiste
et d’aller contre la science?
J. R.: Je suis convaincu de la valeur inestimable
de la génétique. Le problème ne concerne pas cette
science, mais ses applications. Nous devons choisir entre la méthode
douce et la méthode dure pour entrer dans le XXe siècle.
Dans l’agriculture, la méthode dure consisterait à produire
des plantes transgéniques avec les risques environnementaux et sanitaires
que cela implique. Au contraire, la méthode douce mettrait la génétique
au service d’une agriculture biologique durable et élaborée.
Nous devons nous imposer deux règles: ne pas causer de dommages
et toujours opter pour le système qui laissera le choix le plus
ouvert possible aux générations futures.
-
Qui se cache derrière ce commerce génétique
naissant?
J. R.: Ce sont des entreprises géantes,
comme les grands groupes chimiques qui ont commencé à se
séparer de leurs départements de chimie pure pour se concentrer
sur les sciences de la vie. Ils sont en train de passer de l’ère
de la pétrochimie à celle de la génétique commerciale.
Les gènes seront au XXe siècle ce que le pétrole,
les minerais et les métaux ont été à l’ère
coloniale et industrielle: une matière première.
L’enjeu de ce commerce a un nom: brevets. Dans les 10 années
à venir, on aura isolé la quasi-totalité des 60 000
gènes qui constituent notre patrimoine génétique.
Pratiquement chacun d’entre eux sera la propriété intellectuelle
de ces firmes, pour 20 ans au moins. L’idée de breveter les gènes
est une escroquerie. Les législations européennes et américaine
estiment qu’un produit brevetable doit être original et utile. Mais,
en 1987, l’Office américain des brevets a ajouté à
ses textes un paragraphe spécifiant qu’il est désormais possible
de faire breveter toute forme de vie génétiquement modifiée,
à l’exception des êtres humains après la naissance
— la seule et unique raison à cette restriction étant que
la constitution des Etats-Unis interdit 1’esclavage.
-
Ne simplifiez-vous pas le problème? Les
brevets ne couvrent pas réellement les gènes, ils permettent
aux entreprises et aux chercheurs de protéger juridiquement les
méthodes qu’ils mettent au point.
J. R.: Non, on est bel et bien en train de
breveter des gènes. Des milliers de gènes animaux et humains
ont déjà été brevetés. Par exemple,
la société Myriad Genetics a isolé le gène
du cancer du sein, particulièrement chez les femmes ashkénazes
(d’origine juive d’Europe centrale, ndlr). Elle détient un brevet
pour ce gène. C’est son invention. Qu’une femme, où qu’elle
se trouve dans le monde, subisse un test de dépistage pour ce gène
précis, et une partie de la somme qu’elle paiera reviendra à
cette entreprise sous forme de royalties.
-
Comment comptez-vous concrètement inverser
cette tendance, quand on connaît l’ampleur des enjeux financiers?
J. R.: Avec mon éminent collègue
du New York Medical College, le microbiologiste Stuart Newman, nous avons
déposé une demande de brevet portant sur 30 manipulations
couvrant toutes les combinaisons possibles de chimère animal-humain
créées pour les besoins de la recherche médicale (humain-chimpanzé,
humain-porc, etc.). Il n’existe pour le moment aucun brevet sur ce genre
de chimères. Si nous obtenons satisfaction, nous invoquerons la
«protection génétique» pour interdire à
tout chercheur de franchir la barrière des espèces en croisant
des cellules d’homme et d’animal. Ce brevet étant valable 20 ans,
cela devrait laisser aux pays le temps de débattre de la question
et, espérons-le, d’adopter une législation rendant les organismes
transgéniques hors-la-loi.
-
Des pays comme les Etats-Unis et des organisations
comme l’OMC pressent les pays en développement de prendre pour modèle
la législation américaine sur les brevets, sous prétexte
que cela protégerait leurs propres ressources naturelles contre
toute exploitation étrangère. Que leur conseilleriez-vous?
J. R.: Deux attitudes sont en concurrence,
et à mon sens, aucune n’est la bonne. La première est celle
des firmes multinationales. La seconde, défendue par de nombreux
pays en développement, consiste à dire: notre richesse génétique
est une ressource au même titre que le pétrole du Moyen-Orient.
Nous réclamons des compensations, sinon, c’est de la piraterie biologique.
Mais sur quelles bases indemniser quand il s’agit de patrimoine génétique?
Et qui faut-il indemniser? La société Merck and Co. entretient
à ce titre une relation absurde avec le Costa Rica. En échange
d’un droit d’accès à tout le patrimoine génétique
du pays, elle offre un million de dollars à une organisation locale
à but non lucratif. Mais qui cette organisation représente-t-elle?
Le patrimoine génétique ne doit pas être réduit
par les gouvernements ou les entreprises à sa seule dimension commercialement
exploitable. J’aimerais que des pays génétiquement aussi
riches que l’Inde trouvent une troisième voie qui garantisse à
chacun le libre accès à ce patrimoine, comme nous l’avons
fait pour l’Antarctique, grâce à des conventions et des traités.
Sinon, il y aura au XXe siècle des guerres pour les gènes,
comme l’ère industrielle a connu des guerres pour le pétrole,
les métaux et les minerais. Et cette course à la maitrise
du patrimoine génétique, avec les conflits qui l’accompagneront,
creusera encore davantage le fossé actuel entre les possédants
et les démunis.
-
Si cette question est à ce point importante,
comment se fait-il qu’elle ait si peu provoqué de débat public?
Les médias en sont-ils responsables?
J. R.: La plupart des journalistes scientifiques
et économiques ont traité le sujet sous l’angle anecdotique,
se contentant d’annoncer la naissance d’une nouvelle variété
de plante cultivable ou une percée dans le domaine médical.
Beaucoup d’auteurs scientifiques ne veulent pas mettre en péril
la relation privilégiée qu’ils entretiennent avec les microbiologistes
et les entreprises. Ils ne sont pas non plus assez sûrs d’eux pour
défier les spécialistes sur leur propre terrain. Mais surtout,
les médias n’ont pas encore réalisé l’ampleur véritable
de ces questions, car ils sont obnubilés par la révolution
de l’information.
-
L’industrie chercherait-elle à étouffer
ce débat?
J. R.: Il n’y a pas de complot. Simplement,
les vannes du marché s’ouvrent très rapidement, et les dirigeants
des grandes entreprises de biotechnologies s’y engouffrent avec l’obsession
de gagner un maximum d’argent et de gonfler leurs portefeuilles d’actions
le plus vite possible. Ils ne veulent surtout pas que le mouvement puisse
être ralenti par un débat public.
On retrouve ici la pensée libérale qui estime que le marché
est l’arbitre final, celui à qui il revient de décider des
technologies à exploiter et de la meilleure façon de le faire.
Pour moi, l’idée de laisser le marché et les consommateurs
décider de notre futur est la plus terrifiante des perspectives.
-
Comment expliquez-vous la véhémence
avec laquelle les scientifiques réagissent dès que quelqu’un
met leurs travaux en cause?
J. R.: Il y a, chez les scientifiques, une
certaine arrogance. C’est particulièrement le cas quand il s’agit
d’une science émergente. On en a déjà fait l’expérience
avec les chimistes, puis les physiciens. Maintenant, c’est le tour des
biologistes. Cette arrogance plonge ses racines dans la vieille conception
de la science énoncée par le philosophe anglais Francis Bacon,
et fondée sur le pouvoir. Pour lui, la nature est une «vulgaire
fille publique, farouche, qu’il faut dompter, contraindre, modeler et façonner».
Il disait aussi que «la connaissance est source de puissance»
et que «nous pouvons être maitres de notre destinée».
De nombreux microbiologistes — mais pas tous — trouvent excitante l’idée
d’être capable de contrôler le destin, de jouer à être
Dieu. Ils sont les seuls à pouvoir, non seulement décrypter
le code de la vie, mais aussi l’utiliser. Ils imaginent que si nous étions
capables de comprendre leurs travaux, nous les approuverions. Mais, pour
eux, être informé signifie comprendre les choses comme ils
l’entendent, et donc partager leur morale. Ces scientifiques ne croient
pas vraiment au principe démocratique. On a déjà vu
cela avec la pollution pétrochimique et l’énergie nucléaire.
-
Peut-on établir un lien entre cette arrogance
et la désaffection croissante vis-à-vis de l’idée
selon laquelle une espèce vivante possède une nature essentielle,
une valeur intrinsèque?
J. R.: Oui, vous touchez là à
un point essentiel. Les êtres vivants ne sont plus perçus
comme des oiseaux ou des abeilles, mais comme des paquets d’informations
génétiques. On a vidé les êtres vivants de leur
substance, en réduisant la vie à un simple code à
déchiffrer. Il n’y a plus rien de sacré. Comment d’ailleurs
pourrait-il en être autrement lorsqu’il n’existe plus de frontières
biologiques identifiables à respecter? Dans cette nouvelle façon
de penser l’évolution, on peut mélanger, apparier, croiser
tout ce qu’on veut dans le monde biologique.
On réécrit les lois de la nature pour les mettre en conformité
avec nos manipulations. La vieille notion darwinienne de survie du plus
fort est remplacée par celle de survie du mieux informé.
L’être humain accélère maintenant le processus de l’évolution
en reprogrammant la nature grâce aux instruments que lui fournit
la génétique.
Cette nouvelle cosmologie justifie l’emploi de la méthode dure,
en nous assurant que nous ne faisons que suivre l’ordre naturel des choses
et la voie tracée pour nous par la nature. A la prochaine étape,
les microbiologistes ne parleront plus de génie génétique,
une expression bien trop froide, mais ils compareront les humains et les
autres êtres vivants à des ceuvres d’art inachevées.
Les biotechnologies seront alors conçues comme des «instruments
artistiques» puissants, permettant à leurs utilisateurs de
parachever l’ébauche.
-
Au terme d’une description terrifiante du siècle
prochain, votre livre s’achève sur cette phrase: «Le reste
dépend de nous». C’est plutôt frustrant. Que pouvons-nous
faire?
J. R.: Il serait absurde de décréter
ce qui doit être fait. Au lieu de cela, j’ai décrit deux voies
possibles pour entrer dans le XXe siècle. Il appartient maintenant
au public, à la nouvelle génération en particulier,
de s’emparer du sujet, d’en débattre, de poser des questions, de
faire entendre sa voix dans la rue, les médias, devant les tribunaux,
etc.
Même quand des révolutions technologiques et commerciales
bouleversent des civilisations, il y a toujours moyen d’intervenir sur
les nouvelles relations de pouvoir qui se mettent en place, de faire valoir
son opinion. Il faut nous débarrasser du mythe selon lequel la science
est impartiale et la technologie neutre. En prenant conscience de la puissance
d’une nouvelle technologie, nous devrions nous demander si l’usage qui
en est fait est approprié, si nous pouvons en conserver la maitrise,
ou si elle ne risque pas de nous échapper.
-
Ne devenez-vous pas maintenant un peu optimiste?
Ne pensez-vous pas que l’absence de débat trahit une faille sérieuse
dans les institutions de nos sociétés?
J. R.: Je ne suis ni optimiste, ni pessimiste.
Je ne sais pas si la génération actuelle saura faire le bon
choix. Mais je suis plein d’espoir. Il y a d’autres voies pour amener le
changement que de compter sur les institutions, qui entretiennent le statu
quo. Le militantisme ne se limite pas à manifester dans la rue.
Nous ne devons pas seulement formuler notre désaccord, mais aussi
proposer une vision alternative.
-
Pensez-vous que l’opinion publique optera pour
la voie de la prudence?
J. R.: Je pense qu’il n’y a pas encore d’opinion
publique. Une fois que l’attention se sera portée sur le commerce
génétique, le débat se développera très
rapidement, pas seulement dans les milieux militants, mais aussi dans l’industrie.
Il ne s’agira plus uniquement d’un combat entre les citoyens d’un côté
et les grandes entreprises de l’autre: c’est tout le marché qui
sera concerné. Le monde agricole sera le théâtre d’une
confrontation majeure entre producteurs biologiques, distributeurs et entreprises
de biotechnologie dont l’enjeu sera le consommateur. On assistera au même
phénomène dans les domaines de la médecine et de la
santé. Les consortiums pharmaceutiques militeront en faveur de l’introduction
de nouveaux médicaments mis au point selon la méthode dure
(ce à quoi je ne suis pas forcément opposé) et encourageront
le développement des thérapies géniques. De leur côté,
les compagnies d’assurances presseront la même science de rnettre
au point des méthodes de soins préventifs, pour éviter
d’avoir à rembourser des traitements onéreux.
-
L’UNESCO a-t-elle un rôle à jouer
dans ce débat?
J. R.: Il serait intéressant que l’UNESCO
serve en quelque sorte d’amplificateur à la voix des ONG, de façon
à leur donner plus de poids. L’UNESCO ne doit pas nécessairement
prendre position, mais elle pourrait, par le biais de son Comité
international de bioéthique, offrir un forum ou l’on débattrait
de la complexité de ces questions.
Propos recueillis par Amy Otchet et René Lefort.
(Courrier de l'Unesco, Setembro 1998)
|
|
|
|
Glossaire
ensemble des techniques utilisant des organismes vivants ou des substances
organiques pour créer ou modifier des produits, des plantes, des
animaux, ou pour développer des micro-organismes à des fins
spécifiques, comme la fermentation ou le traitement des déchets.
organisme issu de manipulations expérimentales, dont les cellules
proviennent d’au moins deux génomes différents.
groupe d’organismes génétiquement identiques, produit par
le biais d’une reproduction non sexuelle.
étude des possibilités d’améliorer le patrimoine génétique
humain. Historiquement associé à des mouvances politiquement
extrémistes, qui encouragent la reproduction d’individus considérés
comme porteurs de gènes «favorables» et découragent
celle d’individus présumés porteurs de gènes «défavorables».
techniques utilisées pour isoler des gènes dans un organisme,
les manipuler, les transplanter dans un autre organisme.
totalité de la matière génétique contenue dans
une cellule ou un individu.
ADN produit par manipulations génétiques, associant des fragments
d’ADN provenant d’individus ou d’espèces différents.
décrit un organisme dont le génome d’origine a été
modifié par l’introduction d’un gène étranger provenant
généralement de l’ADN d’une autre espèce, à
la suite d’une manipulation.
titre délivré par l'Office américain des marques et
des brevets – qui dépend du ministère du Commerce –, conférant
à son détenteur le droit d’interdire à quiconque,
sur le territoire américain, et pour une durée déterminée
(en général 17 ans), la fabrication, l’usage ou la vente
de l’invention brevetée. Les lois de la nature, les phénomènes
physiques et les simples idées ne peuvent être brevetés.
Source: The Penguin Dictionary of Biology (Penguin, 1996).
|
|